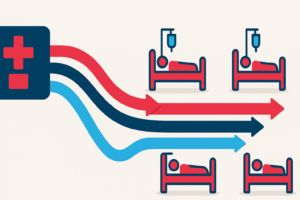Logistique de bloc opératoire : repenser l’efficience et la sécurité grâce au conseil
Dans de nombreux hôpitaux, la logistique de bloc opératoire repose encore sur des pratiques manuelles : commandes papier, suivi empirique des consommations, absence de traçabilité des dispositifs médicaux. Ces méthodes, souvent qualifiées d’inefficientes et risquées, ne permettent plus d’assurer la performance attendue d’un service aussi stratégique que le bloc.